abdelhalim berri
المدير العام
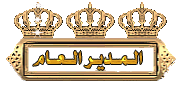

الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI
البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537
التنقيط : 96872
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 11/08/2010
الجنس : 
 |  موضوع: La Nouvelle sociale "Le Vélo" d'après ABDELHAK SERHANE موضوع: La Nouvelle sociale "Le Vélo" d'après ABDELHAK SERHANE  الإثنين 25 أبريل 2011, 11:19 الإثنين 25 أبريل 2011, 11:19 | |
| 
LE VÉLO
ABDELHAK SERHANE
«Si tu réussis cette année ton entrée en sixième, je t'achète un
vélo ! » avait lancé le père de sa voix rauque.
Ce n'était ni une promesse pour m'exhorter au travail, ni une
invite généreuse pour me rendre meilleur. C'était un défi que me
lançait le père au milieu du repas du soir. Ma mère avait levé les yeux
puis les avait baissés dans un geste d'impuissance. Un silence de mort
avait suivi ces paroles. Déjà, je n'avais plus faim. Comme s'il m'avait
poignardé dans le dos. Le ricanement qui avait suivi ses propos
m'avait glacé d'effroi. Je maudis la vie et l'enfance au fond de moi. Le
morceau de pain que j'avais religieusement trempé dans la sauce resta
au fond de l'assiette et se métamorphosa dans le bouillon de légumes.
Je l'abandonnai malgré moi pour lui montrer que ma fierté passait
avant la nourriture. Pourtant, le dîner était délicieux; un tagine aux
sept légumes que savait si bien préparer ma mère. Une boule obstrua
ma gorge mais je résistai de toutes les forces qui me restaient à l'envie
de pleurer. Je réussis à ravaler mes larmes et fus satisfait, malgré tout,
de lui avoir refusé ce plaisir. Le repas fut interminable pour moi et sa
fin une délivrance. Si mes larmes ne coulaient pas, je pleurais à l'intérieur.
Avec les yeux du coeur et avec ma sensibilité d'enfant.
Le sommeil déserta mes paupières cette nuit-là. Une fois seul,
je donnai libre cours à mes larmes abondantes. Je les sentais ruisseler
sur mes joues brûlantes avant de disparaître, absorbées par le
tissu et la laine de l'oreiller. Une seule phrase occupait mon esprit
et résonnait comme un gong au fond de mon être: «Si tu réussis
cette année ton entrée en sixième, je t'achète un vélo!» L'école
était le sujet de prédilection du père. Il me savait susceptible. Mes
résultats étaient nuls en classe.
Les mots bourdonnaient dans ma tête et me donnaient le vertige.
Le ricanement du père écorchait encore mes oreilles et me
donnait des démangeaisons. Je me grattai comme un chien galeux
pour chasser le mal. Mais le mal était à l'intérieur et mon orgueil saignait
toujours. La phrase maudite m'empêchait de réfléchir. Fuguer
me paraissait une bonne solution pour retrouver ma dignité et regagner
l'estime des miens. Fuguer ! mais où aller ? Tous ceux chez qui je
pourrais me réfugier me ramèneraient à la maison illico et je recevrais
le châtiment que je méritais pour chasser à jamais cette idée de ma
tête d'inconscient. Je devais faire preuve de maturité et me conduire
en homme. Les adultes ne me permettraient aucune faiblesse. À leurs
yeux, j'étais un homme. Par conséquent, je devais me conduire avec
sagesse et responsabilité. J'avais onze ans et la peur aux tripes. J'avais
tout le temps peur car tout ce que je disais, tout ce que je faisais était
pesé, jugé et... désapprouvé, blâmé. Devant l'originalité de cette
attitude, je préférais me taire et ne rien faire. Je me rattrapais en
pleurs. Ce soir-là, j'avais décidé de pleurer et d'agir. Le suicide me
semblait répondre parfaitement à cet affront. Je serais tranquille,
retrouverais le calme de la mort et le silence de la tombe. Mais j'avais
plus peur de l'enfer que de la mort. Le rasoir du père pouvait faire
l'affaire. L'acte me paraissait très simple et la mort insignifiante. Je
serais tranquille et le père ne m'aurait plus à portée de sa main pour
me faire supporter sa mauvaise humeur. Quelqu'un m'avait dit un
jour que le suicidé était maudit jusqu'à la fin des temps et qu'il
comptait parmi ceux que Dieu chasserait de son Royaume. Le
suicide me fit peur et j'y renonçai à regret. La phrase maudite
travaillait comme un chancre dans ma tête et faisait des dégâts dans
ma mémoire. J'étais à un doigt de la dépression. J'en voulais à mon
père. Au monde entier pour ce moment de grande douleur. J'étais
seul avec ma peine, seul dans la souffrance, et seul face à mon destin.
Le chant d'un oiseau (ou ce qui m'avait paru être le chant d'un
oiseau) m'arracha à ma méditation. Mes larmes s'arrêtèrent soudain
et mes idées noires se dissipèrent comme par enchantement. La
phrase maudite atténua le poids de son accusation, car dans ma
tête, je m'amusai à la transformer pour lui donner une autre forme
et une autre tournure. Comme un jeu de puzzle, je réussis à
remettre les mots dans le bon ordre et j'obtins ceci: «Réussis!»,
puis: «Tu dois réussir... » Et de fil en aiguille, j'arrivai à ceci: «Je
dois travailler pour réussir et mériter ce vélo !» Je me surpris en
train de parler à haute voix et cela m'amusa. Je disais: « Il me lance
un défi, je lui ferai regretter ses propos. Il sera devant le fait
accompli. Et comme il dent à sauver la face devant nous, il sera
obligé de tenir sa promesse. Puis, avec un vélo, je gagnerai beaucoup
de temps. J'irai plus vite pour faire les courses ou pour me
rendre à l'école. En tous cas, j'irai plus vite que lui. Pour la première
fois, j'irai plus vite que lui et cela vaut tous les sacrifices. » Je
pris alors la résolution de m'appliquer en classe pour ne plus me
sentir coupable et pour ne plus être obligé d'interrompre un repas.
La fin de l'année fut pour nous deux une dure épreuve.
Beaucoup plus pour lui que pour moi car le jour du résultat final, il
ne réussit ni à maîtriser sa colère, ni à dissuader sa mauvaise humeur.
J'avais réussi, dit-il, uniquement pour le contrarier. Ce qui
était vrai mais je me gardais de le lui dire. Pour la première fois, il
était pris dans son propre piège. J'irais plus vite que lui. Une
satisfaction intense me gagna et, le lendemain, en l'absence de mon
père, ma mère laissa éclater son bonheur. Elle m'embrassa sur les
deux joues et me donna de l'argent. Quelques sous qu'elle avait
économisés en revendant les pains de sucre que les invités nous
apportaient en guise de cadeau à l'occasion des fêtes religieuses ou
des cérémonies familiales. C'était sa manière à elle de se venger de
la cupidité du père. Et je l'approuvais dans son acte qui, pensais-je,
constituait un premier pas vers l'acquisition de sa propre liberté.
Un acte d'affirmation de soi même dans la négation.
Je m'arrangeai pour que tous les membres de la famille et tous
nos amis soient au courant de la promesse du père que je considérais
comme un défi. Des paroles qu'il n'avait pas tardé à regretter. Je
n'arrêtais plus de rêver à ce vélo. Vert, rouge ou bleu. Un vélo qui
me permettrait de m'évader dans les prés et sur les chemins perdus.
J'irais plus vite que le père. Plus vite que le vent. Mes camarades me
verraient passer devant eux et ils m'envieraient pour la chance que le
hasard et le manque de perspicacité du père m'avaient offerte. Le
rêve dura près de dix mois et fit place à la désillusion. Le vélo
n'existait désormais que dans ma tête. J'évitais de le rappeler au père
pour m'épargner sa colère. Je savais pourtant qu'il honorerait son
engagement, ne fût-ce que pour ne pas perdre sa crédibilité au sein
de la famille. Un soir qu'il était de bonne humeur, il demanda à ma
mère de nous préparer du thé à l'absinthe. Il dégusta son premier
verre et me dit sur un ton plaisant: «Je t'avais promis un vélo en
récompense de ta réussite. Je suis un homme de parole. Tu auras ton
vélo. Tu iras alors plus vite que le vent, plus vite que moi ! »
Je fus surpris par cette déclaration. Comment avait-il soupçonné
mes pensées ? Ma plus grande vengeance était d'aller plus
vite que lui. Cette bicyclette ouvrirait une nouvelle ère dans nos
rapports. Elle me donnerait plus d'aisance et d'assurance. Le temps
fuirait sous les roues de la mécanique. Je serais l'un des enfants les
plus rapides de mon village. La vitesse me plongeait déjà dans la
griserie et je me sentais des ailes à la place des pieds. Je ne pensais
pas si bien dire car avec des ailes aux pieds, je ne volerais pas loin.
À l'aube d'un matin d'avril, le père prit le car pour se rendre en
ville m'acheter le fameux vélo. Tout le village était au courant de
l'événement. Des hommes vinrent saluer le père à la gare routière et
lui souhaitèrent bon voyage. Les enfants me regardaient avec envie
et jalousie. Certains se rapprochèrent de moi et m'offrirent leur
amitié. L'orgueil grandissait en moi et ceux que je daignais saluer
ou regarder étaient aux anges. J'étais le centre de la terre.
Quand le car démarra dans un bruit d'enfer, des cris de joie
accompagnèrent la mécanique dans son mouvement. Avant le
coucher du soleil, j'aurais un vélo rouge. J'avais demandé à ma
mère d'intercéder auprès du père pour que le vélo soit rouge. Une
sensation étrange et incomparable avait pris possession de mon
être. Une vague sensation de bonheur. Comme si à l'intérieur de
mon ventre, il n'y avait ni estomac, ni boyaux, ni rate, ni foie, ni
poumons, mais uniquement un coeur qui bat dans une cage
thoracique vide. Et mon coeur battait à se rompre de joie. Tous les
gamins me flagornaient. Tous étaient prêts à se rouler à mes pieds
pour que j'accepte leur amitié. Tous faisaient de leur mieux pour
que je surprenne une manifestation de soutien et de sympathie
dans leurs regards, dans leurs gestes ou dans leurs paroles. J'évitais
les regards, faisais semblant de ne pas remarquer les gestes et ne
parlais à personne. Je traversais les rues comme un prince, courtisé
par la ribambelle qui ne me lâchait pas d'une semelle. Des bribes
de phrases me parvenaient et cela augmentait mon orgueil. « Un
type formidable ! », « il est le meilleur de nous tous ! », « c'est mon
ami!», «on ne se quitte jamais tous les deux!», «je le défendrai
contre ceux qui voudront abuser de sa gentillesse!»... Amusé,
j'écoutais les commentaires sans y répondre. Mon pouvoir sur les
autres gosses était absolu. Je serais le premier garnement du village
à posséder un vélo. Et il serait rouge. J'irais plus vite que les autres,
plus vite que le vent même et surtout, plus vite que le père !
Cette journée fut la plus longue de ma vie. On aurait dit que
la grande pendule du temps s'était grippée. Les heures devenaient
des siècles. Dans mon impatience, j'avançai les aiguilles de notre
horloge à poids pour écourter mon attente. Jamais je n'avais vu ma
mère aussi heureuse. Elle organiserait sans doute une petite fête à
cette occasion. Les voisines apporteraient des pains de sucre ou de
l'argent et, ensemble, elles boiraient le thé à ma santé. J'offrais à
ma mère une occasion d'être fière et d'être heureuse.
Dès quatre heures de l'après-midi, un attroupement s'était
formé devant l'entrée du village. Les enfants plus âgés que moi me
félicitèrent. Je distribuai quelques regards plaisants et des sourires.
Deux gamins faisaient le guet sur le pont et deux autres de l'autre
côté de la montagne. Le moment était solennel. Certains hommes
avaient mis leurs djellabas blanches et leurs burnous des grandes
cérémonies. Pour la première fois de ma vie j'étais heureux
Le car arriva avant la tombée de la nuit. Tout le monde était
là. Même l'Imam et le Moqaddem. Une nuée de gamins tourbillonnaient
autour de la mécanique essoufflée. La portière s'ouvrit et
le père apparut enfin, enveloppé dans sa grande cape noire. Des
cris jaillirent de partout. Il serra la main aux hommes qui attendaient
son retour et embrassa l'Imam et le Moqaddem sur les
joues. On s'enquit des nouvelles de la ville.
« Là-bas, c'est autre chose, affirma le père. Les gens sont trop
pressés. Ils courent dans tous les sens. Je me demande s'ils ont le
temps de penser au temps, s'ils ont le temps d'apprécier la fraîcheur
d'une eau de source, l'ombre d'un arbre ou le chant d'un oiseau. Je
crois même qu'ils n'ont jamais vu un arbre, jamais bu l'eau d'une
source et n'ont jamais entendu le chant d'un oiseau. Ils boivent
l'eau dans des bouteilles, ont des plantes en plastique et écoutent
de la musique à la radio. Us n'ont pas d'amis parce qu'ils n'ont pas
de temps à leur consacrer. Ils sont constamment seuls, enfermés
dans une grande agitation et dans une grande lassitude... »
Le père interrompit son discours parce que l'apprenti chauffeur
venait de retirer la bâche qui couvrait les bagages sur le toit.
Tous les regards étaient rivés sur le haut du car. Les battements de
mon coeur s'accélérèrent. Les gosses m'entouraient en me jeunt
des regards attendris. « Le graisseur » lançait sacs et baluchons
qu'un homme costeau attrapait au vol avant de les remettre à leurs
propriétaires. Un triangle en fer passa de main en main. Le père
s'en saisit et me le tendit sans regarder dans ma direction. J'attrapai
le morceau de fer en scrutant les regards autour de moi.
« Un cadre de vélo ! » s'exclama quelqu'un dans la foule. C'était
un cadre de vélo. Un cadre immense. Plus tard, un camarade allait
m'apprendre que c'était un «950»; la plus grande dimension. Tout
au long du chemin qui nous séparait de la maison, je me disais que
dans l'un des deux sacs, il y avait nécessairement toutes les pièces
manquantes. Le guidon, les freins, les pédales, le siège, les gardeboue,
les pneus, les chambres à air, l'avertisseur, les feux... Tout cela
était nécessairement dans l'un des deux sacs. Mais je ne voyais pas
quel sac pouvait contenir les jantes. J'étais intrigué, un peu déçu.
Les gamins nous suivirent jusqu'au seuil de chez nous. Ma mère
nous attendait sur le pas de la porte, le visage rayonnant. Elle céda le
passage au père qui déposa les sacs dans le couloir. Je l'imitai et allai
m'asseoir sur la banquette. Le père fit ses ablutions et accomplit
toutes les prières de la journée. Cela lui prit au moins deux heures.
Quand il eut fini, le dîner était prêt. Il mangea, se leva pour aller
cracher par la fenêtre, dégusta son thé à la menthe, se cura les dents
avec une allumette éteinte, remercia le ciel pour ses bienfaits,
éternua plusieurs fois à rompre les murs, s'essuya le nez et la
moustache, remit sa tabatière dans sa poche, se gratta la fesse droite,
ôta son tarbouche pour laisser respirer sa calvitie, égrena son
chapelet en lisant des prières entre les lèvres... Je pensai: que de
temps perdu, gaspillé dans des gestes à la limite du ridicule. Ailleurs,
les gens font, défont ou refont le monde pendant que le père se
gratte, pète ou prise son tabac. Il n'était pas pressé. Il ne l'avait
jamais été. Il avait toujours pris son temps pour boire son thé, pour
soigner les deux cheveux qui lui restaient, faire ses prières, égrener
son chapelet. Si je comptabilisais ses heures, je dirais que plus de la
moitié de sa vie se dilapidait dans des actes d'une extrême pauvreté.
Dans notre village, le temps ne comptait pas puisque le temps
appartient à Dieu seul. Et les hommes eux-mêmes sont sa propriété.
Dix minutes avant d'aller se coucher, le père s'adressa à moi
dans ces termes: «Tu as fait preuve d'intelligence en réussissant
l'année scolaire. Je t'avais fait une promesse que je tiens à honorer.
Aujourd'hui que Dieu a fait parmi les jours, je t'ai acheté un cadre
de vélo. Chaque fois que j'irai en ville, je t'achèterai ce qui
manque. À présent, contente-toi du cadre! le vélo sera complet
dans deux ou trois ans. Tu dois apprendre à patienter, à prolonger
le plaisir de la possession. Ceux qui se sont pressés sont morts ! va
te coucher à présent ! »
Il avait finalement fallu cinq ans pour que le vélo retrouve
tous ses membres. Chaque fois que le père se rendait en ville, il
ramenait une pièce. Les jantes avaient suivi le cadre, puis les
pédales, puis les pneus et les chambres à air, ensuite, ce fut le tour
du guidon, des garde-boue, des freins et des lumières. Ce qui
m'intriguait le plus dans cette affaire, c'était le temps. Le père ne
lui accordait aucune importance. La morale des adultes par rapport
à la vitesse et au temps était contradictoire. Autant ils nous
recommandaient d'agir vite car, disaient-ils, le temps est un coutelas;
si tu ne le tranches pas il te découpe ! autant ils se plaisaient
dans une espèce de léthargie qui me laissait pantois. Si « le temps
est d'or », « ceux qui se sont hâtés ont trépassé ! »
La contradiction habitait nos aînés. Par conséquent, elle devait
nous habiter nous aussi. «Ne renvoie jamais ce que tu as à faire
aujourd'hui à demain ! », ou bien « La patience est de Dieu Miséricordieux,
la célérité, du Démon!» ou encore: «Cent et une réflexions
valent mieux qu'un coup de ciseau ! » Nous étions tiraillés
entre la sagesse et son contraire, entre le blanc et le noir et nous
comprenions mal comment les adultes arrivaient à concilier les
contraires, sans souffrance et sans culpabilité.
Le père avait tout son temps. C'est d'ailleurs le seule chose
qu'il avait. Et moi qui espérais aller plus vite que lui, ne serait-ce
qu'une fois ! Je devais ronger mon frein et attendre que la Fatalité
m'accorde le privilège d'aller plus vite que le vent. Malgré une
profonde frustration, j'étais content d'assister à la « fabrication » et
au montage, pièce par pièce, de la mécanique. Je l'avais vue grandir
sous mes yeux, comme un bébé qu'on entoure de soins attentifs
et qui garde toujours quelques mystères. Je l'avais aidée à venir
au monde, à se constituer, à prendre forme, et elle avait meublé
mon temps et occupé une grande partie de mes discussions avec
mes camarades qui, assez régulièrement, venaient s'enquérir de
l'évolution de mon vélo et de l'avancement des travaux. Je leur
permettais de faire des réflexions et acceptais même les plus négatives.
Ce vélo était à moi sans m'appartenir entièrement. J'étais
persuadé qu'il appartenait désormais à chacun de nous. Chaque
gamin lui témoignait une espèce d'attachement affectif et une
attention particulière, à tel point que les allusions faites à son
égard devenaient lassantes. Mon vélo était unique en son genre. La
roue de devant était plus petite que la roue arrière. Le guidon faisait
penser à des cornes de bélier. Les pneus de couleur différente.
Le siège adapté d'une mobylette... Mais c'était mon vélo; il me
permettrait d'aller plus vite que le vent, plus vite que le père!
J'oubliais que dans notre communauté, l'individu était une entité
négligeable. Ce vélo m'avait appris l'orgueil !
Quand il fut enfin prêt, le père tenait à l'essayer avant quiconque.
Un attroupement s'était formé devant notre maison. Tout
le village était au courant de l'exploit du père et les hommes
étaient venus pour le féliciter. Ma mère regardait par la fenêtre en
dissimulant mal sa fierté et sa joie. Le père avait mis ses plus beaux
habits. Quelqu'un apporta un plateau à thé pour célébrer cette
extraordinaire occasion. Le père eut droit au premier verre qu'il
dégusta en faisant bruire ses lèvres en signe d'appréciation. L'agitation
était à son comble. J'étais le seul à ne pas partager l'euphorie
générale ni l'enthousiasme du père. Je me rendis compte que
j'étais tout le temps à l'écart de l'événement et que ma solitude
était épouvantable. Les gamins ne m'accordaient plus aucun crédit.
L'admiration dont j'avais été l'objet jusqu'à ce jour venait de
tomber, faisant place à une lamentable indifférence. Tous les regards
convergeaient sur le père et sur la mécanique posée contre le
mur chaulé à neuf pour cet effet. Je regardais de loin, dégoûté par
ce spectacle grossier. La trahison m'était insupportable. Les idées
de fugue et de suicide occupèrent une fois de plus mon esprit.
J'étais durement éprouvé dans ma fierté et dans ma fragilité. Le
père usurpait ma place dans le groupe; celle que je méritais et que
j'avais acquise au début: le centre. Celui de l'intérêt et de l'admiration
des grands et surtout des petits. Le Monstre ne pouvait-il
pas comprendre que c'était vital pour moi; une question d'orgueil,
c'est-à-dire une question de vie ou de mort ?
L'heure de la grande épreuve approcha. L'un des hommes
habillés de blanc lut tout haut la « Fatiha»; la première sourate du
Coran afin qu'Allah assiste le père et chasse le mauvais sort. La tête
haute et l'allure fière, le père ôta sa djellaba et me chercha du regard
pour me la confier. J'évitai ses yeux étincelants de morgue. Il
enfourcha enfin la bête dans une attitude théâtrale et affectée.
Aussitôt, des cris passionnés et des applaudissements crépitèrent de
toutes parts. Dans ma rage, je crus même entendre ma mère lancer
des you-yous pour exprimer sa complicité avec le père. Celui-ci
s'installa confortablement sur la selle et donna quelques coups de
pédales. La foule bigarrée se mit en mouvement, comme un essaim
de mouches bourdonnant autour d'une charogne. Le père était en
tête, le buste droit et le regard flamboyant. Quant à moi, je ne
bougeai pas, me contentant de suivre la scène de loin. Mon enfance
venait d'être trahie. Mon père m'avait volé mon rêve.
Toujours talonné par la multitude tumultueuse, le père s'engagea
sur une pente inclinée et disparut. Bientôt, je ne distinguais
plus que des têtes ballottées par une course folle, quand j'entendis
soudain un grand bruit de ferraille en même temps qu'un choc
violent suivi de hurlements assourdissants. Ma mère referma la
fenêtre aussitôt en poussant un cri de désespoir. Imperturbable
j'attendais la suite des événements. On ramena le père sur le dos
d'un âne. Ses vêtements étaient tout déchirés et couverts de sang.
Il avait la jambe droite cassée et des lésions au visage. Quelqu'un
se chargea de ramasser les restes du vélo dans un couffin qu'il
déposa à mes pieds. La déception et le chagrin se lisaient dans le
regard des gens. C'était terrible. Je restai de marbre. Pour faire
bonne impression, ma mère pleurait en se lamentant sur son sort.
Quelques voisines avaient accouru pour partager ses larmes et son
chagrin. On étendit mon père sur un lit au milieu des pleurs de
mes soeurs et des cris de ma mère. Dieu, le destin ou la fatalité
venaient de me venger. Je pris le couffin et empoignai une pioche.
Je creusai un trou à l'endroit même où le père avait connu l'infortune
et y enterrai le tout. Je n'avais plus besoin de courir, plus
besoin de roues, plus besoin de mécanique car, me dis-je au fond
de moi, avec ou sans vélo, j'irais désormais plus vite que lui ! XYZ        | |
|





